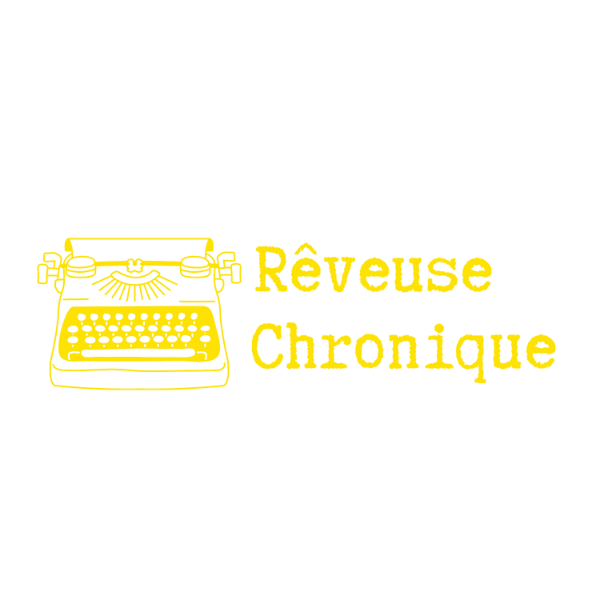En Suisse, quand on évoque la littérature de voyage, Nicolas Bouvier n’est jamais loin, lui qui a démocratisé le genre dès la parution de son Usage du monde en 1963. C’est donc sous son autorité que le genevois Guillaume Guanière place son premier roman, Les Toupies d’Indigo Street : « J’étais parti de Suisse un peu comme on arrache un pansement : vite et sans trop réfléchir. Une année à voyager en Asie et me voilà débarqué au Sri Lanka, sur les traces de Nicolas Bouvier. » (p.11).
L’aventure à corps perdu
La figure de Bouvier n’a ici rien de celle d’un maître, nous y voyons plutôt une boussole, une direction. Guillaume Guanière le connaît depuis un moment, puisque qu’il a consacré son mémoire de Lettres à l’écrivain-voyageur. Bouvier est donc une des raisons, parmi d’autres sans doute, qui pousse le jeune homme a entreprendre un voyage de plusieurs mois en Asie. C’est un compagnon dont Guillaume Guanière emboîte le pas sans jamais mettre les siens dedans, traçant sa propre route.
On peut imaginer qu’après un mémoire universitaire, le jeune auteur genevois a eu envie d’expérimenter une écriture plus sensorielle. Sa plume nous fait percevoir des goûts, des odeurs, goûter des plats, sentir le soleil sur la peau. Le récit mêle subtilement les expériences du quotidien et les pensées du narrateur, usant de phrases courtes et efficaces, sans fioritures. Mais ce style minimaliste invite avec bonheur plusieurs images fortes et poétiques, des nuages comme « larges masses d’un jaune de mégot froid » (p. 55) ou des « étoiles [scintillant] dans la casserole » (p. 61).
Dans Le Poisson-scorpion, Bouvier est coincé au Sri Lanka, malade et enfermé dans une chambre, à « délirer tristement ici pendant neuf mois ? » (p.99). Au Sri Lanka, le récit s’immobilise. Le narrateur des Toupies est lui aussi malade, cloques, éruptions cutanées, fièvres, même un « genre de lupus, une sévère irritation de la peau, entre l’anus et les testicules » (p. 63). Mais son récit suit un double mouvement.
Tourner et retourner la métaphore (analyse et spoils)
La marche, d’abord. Le cœur du récit est celui du pèlerinage des 88 temples de Shikoku, une « longue marche de 1200 km ». Au Japon, le narrateur emmagasine des paysages, des odeurs, des plats cuisinés. Il fait des rencontres, une famille avec laquelle il se fait piquer par une méduse ou Taka, un veuf de 53 ans et son « sourire à réveiller les étoiles » (p.59), il essuie des averses et s’émeut devant des couchers de soleil, collectionne des « instant[s] d’éternité » (p. 56). Ce pèlerinage se ressent comme une quête de sens : « Il paraît que là-haut une vérité me sera révélée, alors je m’accroche à cette idée comme un naufragé à l’espoir d’une terre ; en bon petit chrétien, j’attends ma récompense. » (p.71).
Pourtant, au sommet du dernier temple, l’illumination divine n’apparaît pas, faute à la météo capricieuse ? « Deux mois d’efforts sur plus de mille kilomètres et à l’arrivée, un sommet baignant dans une opaque purée de pois. » (p.73). Un nouvel espoir de révélation se dégage alors que le narrateur arrive au Sri Lanka et s’apprête à se confronter à son modèle. Mais la chambre de Nicolas Bouvier est en travaux et Indigo Street n’existe plus, remplacée par une Rempart Street et recouverte d’un crépi blanc : « Tout est anonyme et uniforme, une page blanche. » (p.106).
Guillaume reste vague sur les raisons et le but de ce voyage, il n’évoque presque pas son pays et pourquoi il a choisi de le quitter si longtemps. On en vient même à se demander avec lui si tout cela à un sens. « Pourquoi penser que chaque question trouverait une réponse, pourquoi vouloir absolument tout expliquer ? » (p. 66). Et le deuxième mouvement s’enclenche.
Le tour en rond, symbolisé dès les toupies du titre, illustré par le trajet des temples des quatre-vingt-huit temples, le seul pèlerinage à former une boucle, et annoncé dès son départ : « Deux mois plus tard, de retour au premier temple, j’écouterai les grincements de la vieille façade en bois, et le silence. Il n’y aura rien d’autre qu’un départ et une arrivée qui se confondent. » (p. 36).
Retour à soi
Est-ce à dire que le récit ou le personnage tourne en rond ? Est-ce que « partir, au fond, ne mène nulle part ? » (p. 73). Peut-être pas. S’il n’a pas eu de puissante révélation, le narrateur garde de son voyage de précieux souvenirs : « En voyage, grapiller de rares instants d’éternité que l’on fait tourner dans son verre, comme un bon vin » (p. 104). Se sentir vivre, et laisser réveiller une et peut-être deux vocations. Car comme le souligne le narrateur, entre le brouillard du temple et le mur décrépi, il reste le blanc, comme une page : « Voilà ce que m’offre cette année d’errance. La révélation qu’il me reste tout mon âge d’homme à écrire ». (p. 107).
Quant aux toupies, si elles réapparaissent en fin de récit, c’est pour mieux se dérober, étant en fait des « poignées de meubles » (p. 110). Est-ce l’épiphanie attendue par celui qui est depuis devenu ébéniste ?